Les vins effervescents
Blanquette de Limoux, Crémant
d’Alsace, Crémant de Bourgogne, Gaillac méthode ancestrale
 Un vin effervescent est généralement un vin
contenant une concentration en CO2 suffisante pour lui conférer, à l’ouverture
de la bouteille, bulles et mousse. Il s’oppose ainsi aux vins tranquilles. Les
vins effervescents français les plus connus sont les vins de Champagne, les
crémants de Loire, de Bourgogne et d’Alsace, la clairette de Die ou encore la
blanquette de Limoux. D’autres vins effervescents sont également produits dans
le Béguey sous l’appellation Cerdon et dans le Gaillacois. L’Espagne produit
également des cavas, et de nombreux vins mousseux (spumante) et pétillants
(frizzante) sont également élaborés en Italie et sur la côte ouest des
Etats-Unis.
Un vin effervescent est généralement un vin
contenant une concentration en CO2 suffisante pour lui conférer, à l’ouverture
de la bouteille, bulles et mousse. Il s’oppose ainsi aux vins tranquilles. Les
vins effervescents français les plus connus sont les vins de Champagne, les
crémants de Loire, de Bourgogne et d’Alsace, la clairette de Die ou encore la
blanquette de Limoux. D’autres vins effervescents sont également produits dans
le Béguey sous l’appellation Cerdon et dans le Gaillacois. L’Espagne produit
également des cavas, et de nombreux vins mousseux (spumante) et pétillants
(frizzante) sont également élaborés en Italie et sur la côte ouest des
Etats-Unis.
Cause de l’effervescence
L'apparition de
mousse ou de bulles lors de l'ouverture d'une bouteille de vin effervescent se
doit aux lois de Henry et de Boyle-Mariotte. Tant que la bouteille reste fermée
aucune bulle ne se forme en son intérieur, le vin a toute l'apparence d'un vin
tranquille (sans bulles). Cependant une certaine quantité de gaz CO2 se trouve
en réalité dissoute à saturation dans le liquide. Par la loi de Boyle-Mariotte
le gaz augmente de volume quand la pression diminue, c'est pourquoi le muselet
en fil de fer a un rôle important : il empêche le gaz de faire sauter le
bouchon en maintenant à l'intérieur une pression supérieure à la pression
atmosphérique ambiante. Le gaz reste ainsi enfermé à volume constant et à
l'état de dissolution dans un liquide. Lorsqu'on ouvre la bouteille la pression
intérieure est immédiatement ramenée à la pression atmosphérique ambiante et
les molécules de gaz se détendent progressivement (loi de Boyle-Mariotte :
moins de pression = plus de volume), en se solidarisant entre elles. Elles
quittent alors l'état de dissolution dans un liquide et passent enfin à l'état
gazeux. Le passage à l'état gazeux se fait à la surface du vin (le point de
contact avec l'atmosphère est aussi appelé « interface air-liquide ») ou sur
les parois du récipient qui le contient.
-
Le passage
à l’état gazeux par l’interface air-liquide ne produit pas de bulle.
-
Les
rugosités des parois du récipient retiennent quelques molécules de gaz au
moment de leur solidarisation. En augmentant de volume ces mêmes molécules
finissent par former une bulle visible à l'œil nu, qui finit à son tour par se
décrocher de la paroi et par monter à la surface. Dans des conditions de
laboratoire et avec des récipients transparents aux surfaces intérieures
parfaitement lisses cela a déjà été prouvé que le Champagne, ou tout autre vin
effervescent, ne produisait pas une seule bulle, en ayant l'apparence d'un vin
blanc ordinaire
Quand la totalité
du gaz dissout dans le vin a été ramenée à la pression atmosphérique ambiante
celui-ci est complètement éventé et perd son effervescence.
Types de vin effervescent
Selon la quantité
de gaz carbonique dissout ou selon la pression de la bouteille :
-
vin
perlant : contient plus d’un gramme de CO2par litre de vin. Des bulles se
forment à 20° lors de l’ouverture de la bouteille.
-
Vin
pétillant : à bouteille fermée et à 20° le CO2dissout subit une
surpression de 1 à 2,5 bars.
-
Vin
mousseux : à bouteille fermée et à 20° le CO2dissout subit une surpression
supérieure à 3 bars.
Le champagne et les crémants sont des vins mousseux.
Méthodes de fabrication
Il existe plusieurs
méthodes permettant d’obtenir un vin effervescent. La plus utilisée est la
méthode traditionnelle, autrefois appelée aussi champenoise. L’usage de l’AOC
Champagne interdit aux autres productions de faire référence à ce vignoble,
elles utilisent alors la mention méthode traditionnelle. Quand
aux vins de Champagne, ils se nomment « Champagne » tout court et
sont les seuls à faire usage de la mention méthode champenoise.
Méthode champenoise ou traditionnelle
La méthode
traditionnelle et la méthode champenoise consistent à
vinifier dans un premier temps un vin tranquille. La fermentation alcoolique,
génératrice de CO2, est donc entièrement réalisée en cuves ou en foudres. Ce
n'est donc pas le gaz émis lors de cette première fermentation qui servira à
créer l'effervescence.
Après un temps
d'élevage choisi par le vinificateur, le vin tranquille obtenu est mis en
bouteille, mais une partie de ce vin ne doit pas être tirée en bouteille car
elle servira a créer les liqueurs de tirage et ensuite de dosage.
On ajoute alors,
dans chaque bouteille, une quantité de ce même vin mais en y ajoutant une dose
de sucre et une dose de levures (la liqueur de tirage). Ces nouvelles levures
vont alors transformer le sucre ajouté en alcool, au cours d'une fermentation
en bouteille. Le CO2 produit lors de cette seconde fermentation alcoolique est
donc piégé dans le contenant, retenu par une capsule métallique, comme celles
utilisées pour les bouteilles de bière. C'est la production de ce gaz, enfermé
et dissout à pression alors même qu'il se répand dans le vin, qui sera
responsable, à l'ouverture de la bouteille, de l'effervescence du vin.
Des lies sont
pourtant produites par les levures mortes et leur production d'alcool et de gaz
carbonique, c'est le dépôt. Une fois la « prise de mousse » effectuée
(c’est-à-dire après arrêt de la fermentation en bouteille lorsque tout le sucre
ajouté a été utilisé par les levures) le vin est laissé en l'état un temps
variable, en fonction de l'appellation et du souhait du vinificateur. C'est le
temps d'élevage sur lattes, sur lesquelles les bouteilles sont placées goulot
vers le bas et inclinées d'entre 30° et 40°. Tous les jours, pendant les trois
ou quatre mois précédant la mise en vente des bouteilles, un remueur effectue
le remuage : il tourne chaque bouteille, selon la méthode de chaque cave, de
1/8, 1/6 ou 1/4 de tour. Il existe de nos jours des machines appelées
"gyro" qui font ce mouvement de remuage régulièrement et
automatiquement, mais quelques producteurs font encore appel aux remueurs
traditionnels. Qu'il soit effectué par un homme ou par une machine le remuage
sert à faire progressivement migrer vers le goulot de la bouteille le dépôt et
les lies que forment les levures ajoutées à la mise en bouteille.
Avant
commercialisation, ce dépôt est donc expulsé lors de la phase de dégorgement.
Il est pour cela nécessaire de geler le dépôt au niveau du goulot, d'ouvrir la
bouteille et d'expulser le glaçon emprisonnant les levures. Quelques rares
producteurs ne gèlent pas le dépôt et dégorgent leur bouteille « à la
volée ». Dans un cas comme dans l'autre, le volume correspondant au dépôt
ôté de la bouteille doit être compensé.
On ajoute pour cela
dans chaque bouteille une dose de vin et de sucre : la liqueur de dosage (dite
aussi d'expédition). C'est la quantité de sucre ajoutée à cette étape qui
détermine le type de vin effervescent produit par méthode traditionnelle : brut
nature, extra-brut, brut, sec, demi-sec et moelleux. « Brut nature »
correspond à ce que certains producteurs appellent aussi « non dosé »
pour signifier que leur vin n'a pas subit d'ajout de sucre après dégorgement.
Une fois le dosage
effectué, la bouteille peut recevoir son bouchon définitif de liège (à la place
de la capsule métallique qui l'obturait pendant la prise de mousse et la
maturation). Un muselet en fil de fer attache fortement le bouchon au rebord du
goulot pour empêcher le bouchon de sauter en dehors de la bouteille.
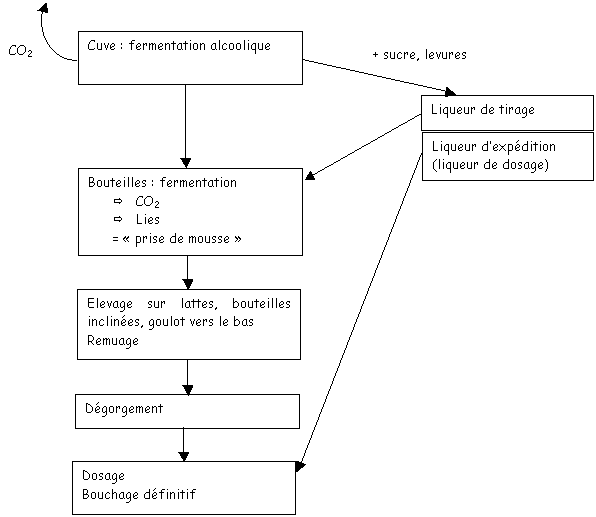
Méthode ancestrale (ou méthode par fermentation spontanée)
C'est la méthode la
plus ancienne, appelée méthode rurale, artisanale ou ancestrale,
dite aussi gaillacoise en fonction de la région. Elle consiste à
effectuer la mise en bouteille du vin précocement, alors que la fermentation
alcoolique du moût n'est pas achevée. Des sucres naturels du raisin et des
levures se trouvent ainsi enfermés dans la bouteille, où la fermentation
alcoolique va pouvoir s'achever. C'est le CO2 produit pendant cette fin de
fermentation naturelle qui va procurer l'effervescence au vin.
Du début à la fin
de la deuxième fermentation les bouteilles restent fermées, en aucun moment
elles ne sont ouvertes pour intervenir dans le processus. Grâce à sa
simplicité, cette méthode ne nécessite aucun tirage, élevage sur lattes,
dégorgement ou rebouchage de bouteilles. Certains effervescents gaillacois et
certaines blanquettes de Limoux sont vinifiés de manière ancestrale.
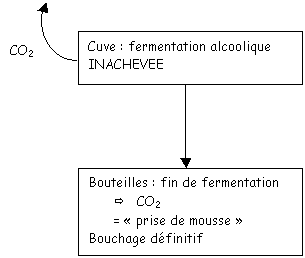
Méthode par transfert
Comme avec les
méthodes traditionnelles ou champenoises la prise de mousse se fait en
bouteille, mais il n'y a pas de dégorgement. Le vin déjà mousseux est retiré de
sa bouteille (les bouteilles sont rincées pour être réutilisées) et filtré de
son dépôt dans une cuve sous pression, où il reçoit une liqueur de dosage.
Toujours sous pression (grâce à une tireuse isobarométrique), le vin est
immédiatement remis en bouteille avec son gaz carbonique naturel.

Méthode dioise
C'est la méthode de
la clairette de Die, du Diois et de la vallée de la Drôme. Elle est similaire à
la méthode ancestrale (sucres et levures naturels du raisin s'occupent de la
fermentation) sauf qu'après la prise de mousse (en bouteille et en cave) on
vidange les bouteilles à froid pour effectuer une filtration des levures, comme
avec la méthode par transfert, mais sans ajout de liqueur de dosage. Entre
temps les bouteilles ont été rincées et sont prêtes à recevoir à nouveau leur
contenu, qui a été filtré entre deux cuves isobarométriques qui maintiennent le
vin à la pression initiale.
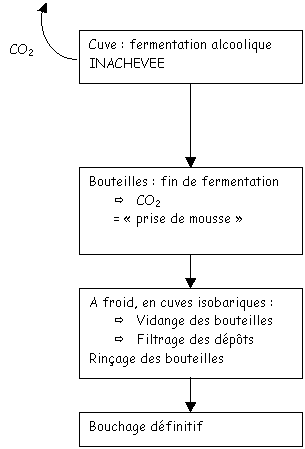
Méthode de la cuve close
La prise de mousse
ne se réalise pas en bouteille mais dans une cuve sous pression. Pour compenser
la perte de gaz carbonique pendant la mise en bouteille un gaz carbonique
alimentaire est autorisé. Auguste Charmat inventa cette méthode en 1907 à
l'université du vin de Montpellier. Elle est utilisée pour fabriquer les Sekt
allemands, les vins sardes, des cidres....
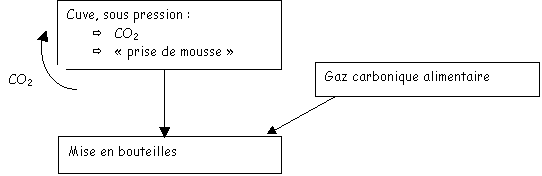
Méthode continue (ou méthode russe)
24 heures sur 24 le
vin circule à l'intérieur d'une série de cuves contenant des copeaux de chêne
ou autres matériaux où les levures se fixent et fermentent le sucre du vin. En
fin de processus, avec la dernière cuve, le vin est mousseux et immédiatement
mis en bouteille par le biais d'une tireuse isobarométrique.
Méthode de gazéification
Le gaz carbonique
ne provient pas d'une fermentation. Un appareil appelé saturateur introduit
dans le vin, sous pression, du gaz carbonique de qualité alimentaire. Une
tireuse isobarométrique s'occupe ensuite de le mettre en bouteille.
Crémant d’Alsace
AOC Crémant d’Alsace depuis le
24 août 1976
Le crémant d'Alsace est un vin d'Alsace AOC pétillant léger (environ 12 % d'alcool) et fruité principalement issu du cépage du pinot blanc, mais aussi du pinot gris, du pinot noir, du riesling, de l'auxerrois ou du chardonnay, sans contrainte de proportions. Il est produit à partir du vignoble d'Alsace.
Sa méthode d'élaboration traditionnelle, identique à celle du champagne, lui apporte sa délicate effervescence. Le crémant rosé d'Alsace, plus rare, est issu du pinot noir. Ses avantages par rapport au Champagne sont d'être en général moins cher (en moyenne 4,58 euros la bouteille en 2005) et plus léger. Par contre le crémant d'Alsace se conserve moins longtemps que le champagne (5 ans maximum). Le crémant d'Alsace est devenu le leader incontesté des effervescents français après le Champagne.
Historique
Le vignoble alsacien dont sont issus les cépages du crémant d'Alsace est l’un des plus anciens de France. Grégoire de Tours vante le vignoble de Marlenheim en 589. On compte cent huit villages viticoles en 800, cent soixante en 900, quatre cent trente en 1400. À cette époque, le vin d’Alsace, en blanc et en rouge, était l’un des plus réputés d’Europe et l’un des plus chers.
De nombreuses guerres, des circonstances économiques défavorables, le maintien d’une législation caduque conduisirent au cours des siècles suivants le vin d’Alsace au bord de sa perte. La situation a été redressée après la Première Guerre mondiale. C'est Julien Dopff au moulin de Riquewihr qui a été le premier viticulteur alsacien à adapter la méthode de champagnisation du vin blanc après avoir assisté à une démonstration de dégorgement du champagne lors de l'Exposition universelle de Paris en 1900. Il commercialise le "Champagne Dopff" après un stage de trois ans à Épernay.
RECOLTE
Le volume de la récolte du raisin servant à la fabrication du crémant d'Alsace a représenté 214 946 hl en 2004, en hausse de 35,6 % par rapport à la moyenne des 5 années précédentes (source Conseil Interprofessionnel des Vins d'Alsace). En 2005 il représente 273 733 hl, nouvelle progression de 27,3% en un an et l'équivalent de 36,5 millions de bouteilles. Le crémant d'Alsace représente en 2006 le quart de l'ensemble des appellations AOC d'Alsace et regroupe 500 producteurs alsaciens indépendants. 10% de la production est destiné à l'exportation, principalement dans le Benelux, en Allemagne, au Danemark, aux États-Unis, en Suède et aux Pays-Bas (par ordre d'importance).
FABRICATION
La vinification des crémants relève d’un processus complexe et demande un véritable savoir-faire. En effet après la fermentation traditionnelle en tonneau, elle consiste à effectuer une seconde fermentation. Pour ce faire, les vignerons rajoutent au vin blanc tranquille (de base) du sucre et des levures. Cette fermentation, qui s’effectue en bouteille, produit du gaz carbonique. Celui-ci, emprisonné, rend le vin mousseux (d’où le nom de l’étape : « prise de mousse »). Parallèlement, le sucre disparaît pour former l’alcool. Après une période de vieillissement sur lattes actuellement fixé à 9 mois (il est prévu de passer à 12 mois), les bouteilles sont tournées sur leur pointe afin que le dépôt se dépose dans le col en attendant l'heure du dégorgement. Le dépôt est alors évacué par refroidissement avant de poser le bouchon et le muselet.
Il est produit en Alsace essentiellement à Barr, Bennwihr,
Eguisheim. Ingersheim, Riquewihr,
Wintzenheim, etc...
AOC
L’appellation « A.O.C. Crémant d'Alsace » désigne les vins mousseux d'Alsace. Ces vins sont élaborés en Alsace selon les méthodes en vigueur pour le Champagne. Ils proviennent de cépages cultivés sur l’aire « A.O.C. Alsace ». Les cépages autorisés à l'élaboration des vins portant l'appellation « A.O.C. Crémant d'Alsace » sont le chardonnay, le pinot auxerrois, le pinot blanc, le pinot noir, le riesling et le tokay pinot gris.
Les raisins destinés à l’élaboration des vins portant l’appellation « A.O.C. Crémant d’Alsace » sont vendangés plusieurs jours avant ceux destinés aux vins portant les appellations « A.O.C. Alsace » et « A.O.C. Alsace Grand Cru ». Comme pour le champagne, la récolte s’effectue manuellement. La machine à vendanger est interdite. Les vins portant l’appellation « A.O.C. Crémant d’Alsace » sont obligatoirement mis en bouteille dans leur région de production. Ils sont présentés dans les mêmes bouteilles que les vins portant l’appellation « A.O.C. Champagne ». Les vins portant l’appellation « A.O.C. Crémant d’Alsace » sont commercialisés complétés de mentions suivant leur composition. Ces mentions sont Blanc de Blancs, Blanc de Noirs, Brut, Millésimé, Rosé, Sigillé. La mention de cépage est autorisée si 100% du vin est produit avec ce cépage.
CONSOMMATION
Le crémant d'Alsace doit être servi dans des flûtes entre 5 et 7 °C. Il constitue un apéritif raffiné idéal pour les cocktails, les réceptions, les fêtes ou tout au long d'un repas. Il accompagne avec excellence les plats aux fruits de mer ou le fromage
Crémant de Bourgogne
AOC Crémant de Bourgogne depuis le 17 octobre 1975
PRESENTATION
La Bourgogne élabore un crémant de grande qualité qui nécessite des soins longs et délicats, un savoir-faire sans faille et une grande expérience. Issu principalement des cépages Pinot Noir et Chardonnay, il est élaboré selon la stricte méthode champenoise dictée par l’ INAO.
Aujourd’hui, 240 producteurs regroupés au sein de l’Union des Producteurs et Elaborateurs de Crémant de Bourgogne (UPECB) partagent la même passion pour l’art du Crémant.
Les Crémants de Bourgogne sont Blancs ou Rosés. Les Crémants de Bourgogne blancs peuvent être « Blancs de Blancs » ou « Blancs de Noirs ».
SITUATION
L’appellation Crémant de Bourgogne s’étend sur un territoire particulièrement important, du Chablisien et du Châtillonnais aux portes de Lyon, en passant par les vignobles des Côtes de Nuits, Beaune, Chalonnaise et Mâconnaise.
LIEU
Rully en Saône-et-Loire en est la capitale bourguignone.
HISTORIQUE
L’histoire du Crémant de Bourgogne a commencé au début du XIXe siècle. En 1822, les frères Petiot, négociants à Chalon-sur-Saône et propriétaires de vignes à Mercurey et à Rully, embauchent un jeune Champenois de talent, François-Bazile Hubert. Ce dernier, fort de ses connaissances acquises dans une maison de Champagne, convainc les frères Petiot de lancer leur première production selon la méthode champenoise. En 1826, ils commercialisent leur vin mousseux sous le nom de « Fleur de Champagne – Qualité Supérieure ».
Déjà en 1827, un million de bouteilles sont vendues… Bientôt 5 millions de bouteilles se dégustent sur les meilleures tables de la capitale.
Sous l’impulsion de Michel Esclavy, un groupement de viticulteurs voit
le jour dans l’Auxerrois, en 1970. Ils sont à l’origine des conditions de production strictes, un savoir-faire traditionnel mais rigoureux et une technique de vinification de haute qualité.
Grâce à ce souci d’excellence, le " Bourgogne Mousseux "obtient le 17 octobre 1975, l’Appellation d’Origine Contrôlée « Crémant de Bourgogne ».
AOC
Un crémant de Bourgogne est une appellation viticole qui s'applique à :
- des vins blanc mousseux, issus pour 70% au moins de cépages principaux ;
- des vins rosés mousseux, seconde fermentation en bouteilles.
Comme pour le champagne, les crémants peuvent être brut, demi-sec ou doux, selon la quantité de sucre rajoutée
L’ A.O.C. Crémant de Bourgogne se décline en 4 couleurs :
- Le Crémant de Bourgogne Blanc est issu d’un assemblage des différents cépages autorisés, dont aucun ne prédomine vraiment, mais qui doit compter un minimum de 30% de Pinot Noir et/ou de Chardonnay. Bien équilibré, avec des arômes complexes, il est le complice de toutes les occasions.
- Le Crémant de Bourgogne Blanc de Blancs est élaboré à partir de cépages blancs uniquement, principalement le Chardonnay. Sa fraîcheur et sa vivacité en font le compagnon idéal de l’apéritif ou accompagne certains poissons et entremets.
- Le Crémant de Bourgogne Blanc de Noirs élaboré à partir du cépage Pinot Noir est plus structuré et vineux. Il se sert à l’apéritif, mais accompagne aussi idéalement tout un repas.
- Le Crémant de Bourgogne Rosé est composé de Pinot Noir seul ou assemblé avec un peu de Gamay. Le premier, très pâle, aux arômes légèrement minéraux est très élégant à l’apéritif. Le second, très fruité, aux arômes de baies accompagne les entrées et les grillades des belles soirées d’été. Il sera également très apprécié sur un sorbet aux fruits rouges.
CONSOMMATION
Tout un repas… au Crémant !
Apéritif
Si les Crémants de Bourgogne sont parfaits à l’apéritif, ils peuvent parfaitement accompagner tout un repas. Des Crémants blancs au nez intense, de fruits, de brioche, s’accordent sur des entrées.
Entrées, poissons et crustacés
Un Crémant blanc de blancs frais, aux arômes d’agrumes accompagnera des noix de Saint Jacques ou des poissons de rivière. Sa fraîcheur aromatique et sa légère acidité accompagneront à merveille le fumet du poisson.
Viandes et volailles
Les Crémants de Bourgogne plus vineux, le “blanc de noirs”, où le pinot apporte structure, charpente et ampleur ne peuvent faire qu’un beau mariage sur une viande, idéalement une volaille fermière, une poularde de Bresse.
Desserts glacés et petits fours
Trouver un vin de dessert n’est jamais simple, le Crémant de Bourgogne rosé est pourtant dans ce cas là un choix judicieux. L’association pinot noir et gamay évoque des arômes puissants de fleurs, de roses, qui s’allient parfaitement aux glaces. La vinosité, l’ampleur apportent longueur en bouche, fraîcheur sur une fin de repas ; il s’accordera alors parfaitement aux petits fours. Mais, ce sont surtout ses arômes fruités qui créent l’association parfaite du Crémant rosé avec un sorbet aux fruits rouges.
Blanquette de Limoux
AOC Blanquette de Limoux depuis le 18 février 1938
PRESENTATION
La Blanquette de Limoux est un mousseux français du Languedoc, c’est un vin d’appellation d’origine contrôlée (AOC) depuis 1938. L’AOC Blanquette de Limoux est la première AOC créée dans le vignoble du Languedoc.
On distingue la blanquette de Limoux dite brute et la blanquette de Limoux dite méthode ancestrale. Ce vin appartient au vignoble de Limoux avec le crémant de Limoux.
SITUATION
Située dans le département de l'Aude et la région Languedoc-Roussillon il est produit dans les environs de la ville de Limoux, à l'ouest des Corbières. Les versants sud des coteaux sont réservés à l'appellation et présentent une combinaison de terres argilo-calcaires légères et caillouteuses.
CLIMAT
Le climat de Limoux est favorable à la production de blancs. La zone est influencée par la Méditerranée et l'océan Atlantique procurant un ensoleillement important et une pluviométrie bien répartie dans l'année et suffisante.
HISTORIQUE
Il est considéré comme le vin mousseux le plus ancien au monde, il fut mentionné pour la première fois en 1531 par les moines de l'abbaye bénédictine de Saint-Hilaire. Tite-Live louait à l'époque romaine les vins blancs de Limoux qui n'étaient pas encore effervescents. Ce sont les moines bénédictins de Saint-Hilaire qui découvrent la transformation du vin blanc en vin effervescent. Des écrits attestent de la fabrication et de l'exportation de flacons de Blanquette en provenance de Saint-Hilaire.
AOC
L'AOC blanquette de Limoux est l'une des premières AOC créées en France. L'aire de production est délimitée dès 1929 et le décret qui fixe l'aire de production de l'AOC sort le 18 février 1938.
CEPAGES
La Blanquette de Limoux est fabriquée à partir de trois cépages :
- le Mauzac est majoritaire avec un minimum de 90%
- le Chardonnay
- le Chenin blanc
Pour la blanquette de Limoux méthode ancestrale, seul le Mauzac est utilisé. Pour la blanquette brute, les trois cépages sont utilisés avec 90 % de Mauzac tandis que le crémant possède 70% de Mauzac et 30% de Chardonnay.
VINIFICATION
La Blanquette et le Crémant ont les mêmes modes de fabrication. Seule la blanquette méthode ancestrale est vinifiée de façon différente.
- Pour la Blanquette, une première fermentation est effectuée séparément pour les différents cépages. On obtient alors des vins de bas que l’on assemble. A cet assemblage on ajoute une liqueur de tirage pour provoquer une seconde fermentation qui se déroule en bouteille. C’est durant cette deuxième fermentation que le vin devient effervescent. Après 9 mois de repos, les bouteilles sont ouvertes pour éliminer le dépôt qui subsiste. On ajoute ensuite la liqueur d’expédition qui donne un caractère brut ou demi-sec. La bouteille est enfin bouchée d’un bouchon de liège définitif.
- Pour la Blanquette méthode ancestrale, la fermentation est entièrement naturelle et la mise en bouteille se déroule à la veille de la Lune de mars. Le vin produit contient moins de 7° d’alcool.
DEGUSTATION
Robe
Jaune pâle, brillante avec une fulgurance de reflets verts ou jaunes… La Blanquette de Limoux, rafraîchie lentement à 6/7°C, offre des bulles nerveuses, finissant en cordon.
Nez
Evoque fruits et fleurs de printemps, la pomme verte et le miel.
A déguster
De préférence dans les deux ans qui suivent son acquisition, pour accompagner tout un repas, et plus spécialement les plats de terroir, dans sa version « brut » et aux côtés des desserts dans sa version « demi-sec ». Elle ne dédaigne pas l’arôme chaleureux du chocolat.
Gaillac
AOC Gaillac depuis décembre 1997
PRESENTATION
Entre les vignobles de Bordeaux et du Languedoc Roussillon, les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées ont su perpétuer leur vocation vinicole, à travers une mosaïque de vignobles très divers, regroupés sous la dénomination Vignobles du Sud-Ouest.
Des rives de la Dordogne à la vallée du Lot, du Pays Basque à la Gascogne et à l'Agenais, du sud du Massif Central aux Coteaux du Tarn, des terrasses bordant la Garonne jusqu'aux portes de Toulouse ... les Vignobles du Sud-Ouest nous font découvrir la plus vaste collection de cépages spécifiques, de vins et de spiritueux typés, tous riches d'une grande histoire.
Le Comité Interprofessionnel des Vins du Sud-Ouest créé officiellement en décembre 1997 regroupe 13 appellations d'Aquitaine et Midi-Pyrénées. On y retrouve ainsi 5 AOC (Côtes du Frontonnais, Gaillac, Madiran, Marcillac, Pacherenc du Vic Bilh) et 7 VDQS(Côtes du Brulhois, Côtes de Millau, Côtes de Saint Mont, Estaing, Entraygues et Fel, Lavilledieu et Tursan).
Parmi cette mosaïque de vignobles très divers, vous trouverez à 50 km à l’est de Toulouse, en direction d’Albi dans le département du Tarn, le vignoble de Gaillac. Il s’étend sur les 2 rives du Tarn, et vers le nord jusqu’à la cité médiévale de Cordes.
L’AIRE D’APPELLATION GAILLAC
Situé dans le nord du département du Tarn, l'aire d'Appellation Gaillac couvre 2 500 hectares répartis sur 73 communes pour une production AOC de plus de 165 000 hl.
Aujourd'hui, l'Appellation regroupe une centaine de caves particulières et trois caves coopératives.
La variété des terroirs (au nombre de trois) et l'ancienneté du vignoble permettent à Gaillac de présenter un encépagement varié et traditionnel. Ainsi, cette diversité du vignoble gaillacois se traduit par une grande variété de vins élaborés qui composent une gamme multiple de vins blancs secs, doux et perlés, de vins rouges et rosés, d'effervescents.
Les ambitions du vignoble sont aujourd'hui portées par une nouvelle génération de vignerons, qui ajoutent à la passion de leurs pères le pragmatisme de formation de haut niveau.
Outre les dernières technologies viticoles, leur savoir-faire s'étend également aux techniques de commerce et de gestion.
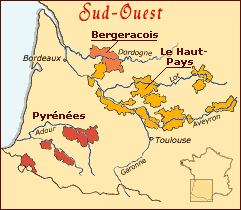

AOC Gaillac mousseux
Vin mousseux selon la Méthode gaillacoise.
DEGUSTATION
Servi frais, peut accompagner tout un repas : saumon mariné au citron vert, mousseline de brochet à la crème de homard, ou un émincé de blanc de poulet au foie gras.
Méthode gaillacoise
LE NOM DU DOMAINE
Domaine d’Escausses
L’APPELLATION
AOC Gaillac
LE VIN DEGUSTE
Méthode gaillacoise
LE MILLESIME
sans
LA PETITE HISTOIRE
A Sainte Croix, la viticulture est traditionnelle. Riche des enseignements de nos aïeuls et parents, elle ne s'adapte que mieux aux exigences du présent. L'obsession de qualité impose naturellement ses choix.
Tout au long de l'année, de la taille aux vendanges effectuées manuellement sur certaines parcelles, du pressoir jusqu'à la mise en bouteille, notre travail met tout en oeuvre pour que naissent des vins de grande tradition, authentiques, à la personnalité affirmée.
"Ces vins, justes et sans détours, sont le reflet d'un mode de vie, de convictions sincères et d'une certaine part de fantaisie."
LA DEGUSTATION
Fruité (pomme, pêche), finale de bonne nervosité.
LE DOMAINE
Le Domaine d'Escausses fait partie de l'association "Terres de Gaillac" qui regroupe une dizaine de vignerons très dynamiques dans l'appellation.
Depuis 7 générations sur cette terre Tarnaise, à flanc de coteaux, la famille Balaran élabore des vins généreux qui mettent les tables en fête. Sans terroir harmonieux, pas de promesse de récoltes heureuses, de nectars équilibrés, de breuvage sincères. Il en est ainsi, ce lieu accueil la vigne naturellement. Elle s'y sent bien, s'exprime avec bonheur.
Le Terroir
C'est de la roche mère calcaire ou marno-calcaire, héritée de l'époque tertiaire, que jaillit l'étincelle. A une altitude moyenne de 250 mètres, en exposition idéale, sud-est à sud-ouest, les vignes, années après années consacrent l'union étroite du végétal et du minéral.
Les Cépages
Age de la vigne
La vinification et élevage
COMMENT LE BOIRE ?
Vin moelleux, pour
l’apéritif.
La Cuvée, Crémant d’Alsace A .
Zirnhelt
LE NOM DU DOMAINE
A. Zirnhelt
L’APPELLATION
AOC Crémant d’Alsace
LE VIN DEGUSTE
La Cuvée
LE MILLESIME
sans
LA PETITE HISTOIRE
LA DEGUSTATION
LE DOMAINE
Les vignerons réunis, Eguisheim
Le Terroir
Les Cépages
Pinot blanc, Riesling
Age de la vigne
La vinification et élevage
COMMENT LE BOIRE ?
Apéritif,
pâtisseries ou salades de fruits.
Crémant de Bourgogne Charles Reaumand
LE NOM DU DOMAINE
Charles Reaumand
L’APPELLATION
AOC Crémant de Bourgogne
LE VIN DEGUSTE
Crémant de Bourgogne Brut
LE MILLESIME
sans
LA PETITE HISTOIRE
LA DEGUSTATION :
LE DOMAINE
Le Terroir
Les Cépages
Chardonnay
Age de la vigne
Rendement
La vinification et élevage
COMMENT LE BOIRE ?
GARDE
Bulle de Blanquette

LE NOM DU DOMAINE
Sieur d’Arques
L’APPELLATION
AOC Blanquette de Limoux
LE VIN DEGUSTE
Bulle de Blanquette
LE MILLESIME
2003
LA PETITE HISTOIRE
Cette cuvée est le fruit de 25 ans de recherche en matière de sélection au terroir. C’est un vin léger aux arômes primaires de fruits à chair blanche de type pêche et poire et aux notes d’évolution toastées et briochées, dignes des plus grands vins à bulles toutes appellations confondues.
LA DEGUSTATION :
Œil : robe d’un joli
jaune pâle aux reflets verts. Bulles fines et persistantes à la mousse
délicate.
Nez : ce vin
présente des arômes de fleurs blanches (aubépine et acacia) et de fruits à
chair blanche qui s'associent avec subtilité aux notes de fruits secs et
empyreumatiques tels que des arômes de grillé, de toasté, de brioché apportant
l'harmonie au bouquet par sa fraîcheur et sa vivacité.
Bouche : L'attaque
est franche et vive avec une agréable sensation d'onctuosité apportée par les
bulles.
L’ensemble est
harmonieux.
LE DOMAINE
Le groupe coopératif Sieur d’Arques de Limoux dans l’Aude s’attaque à son déficit d’image et déploie sa nouvelle stratégie en investissant 1M€ par an pendant trois ans sur ses marques. Objectif : faire connaître et valoriser auprès des consommateurs français et étrangers le plus ancien vin effervescent français, l’AOC Blanquette de Limoux, dont la coopérative assure 65 % de la production et de la commercialisation. Deux marques sont mises en avant par l’agence Devarrieux Villaret en charge du projet. «Aimery», la marque pilier de l’entreprise en grande distribution est relookée et repositionnée avec un assemblage original de cépages chardonnay, pinot et chenin. Une nouvelle cuvée haut de gamme, «Bulle de Blanquette», fruit d’une sélection rigoureuse à la parcelle, vient d’être lancée. Cette nouvelle marque se veut transversale : elle est en effet proposée chez les cavistes, en restauration et en grande distribution à l’exportation.
Les Cépages
Mauzac
COMMENT LE BOIRE ?
Servir à 7-8°C.
Idéale (La Bulle de Blanquette !) à l’apéritif, elle accompagne les mets
des plus délicats.


Restaurant Le Bateau Lavoir
Le Bouscat
Alliances mets et vins
Gaspacho de chèvre
frais
Pavé de Maigre au
fenouil
Tarte fine aux
abricots frais
Soirée du 9 juillet 2008
![]()